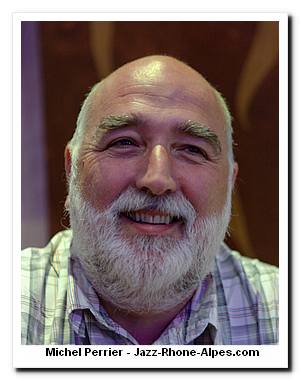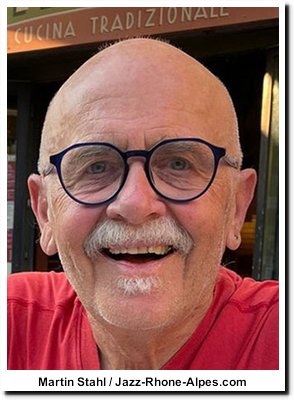L’état de grâce.
Le pianiste Alfio Origlio n’imaginait cette rencontre avec LA voix de sa carrière que dans ses rêves les plus fous, quand sa trajectoire a croisé celle de Célia Kameni, avec qui il allait enfin pouvoir donner la pleine mesure à son idéal musical. Ne manquait plus que LA rythmique adéquate pour que la fiction devienne réalité, en la personne de Brice Berrerd à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie. Le mystère de l’alchimie a fait son œuvre, la juxtaposition de chacune de ces cultures, goûts et expériences a trouvé ses connexions : les fondations sont posées. Pour le cadre, le quartet s’est fixé comme seule et unique ambition d’inscrire au répertoire des chansons qu’ils auraient envie de jouer ensemble, connues ou méconnues, modernes ou patinées par les ans, piochées dans la chanson française, la pop music, le rock ou les standards de jazz. Alfio Origlio met tous ses talents d’arrangeur au service de ce projet, et les pièces en ressortent complètement remaniées, parfois profondément, laissant planer l’incertitude jusqu’à la révélation attendue d’un thème ou d’un texte reconnaissable entre mille. La suite se passe sur la scène, qui est le véritable lieu de création du quartet. Personne n’a peur de rien, chacun sait que les propositions harmoniques ou rythmiques les plus audacieuses trouveront un écho enthousiaste pour des développements intrépides, et que quoi qu’il arrive, le retour à la case départ sera toujours assuré impeccablement. Un véritable espace de liberté dans lequel s’engouffrent tous les musiciens.
Quoi de mieux pour démarrer qu’on petit Stevie Wonder de derrière les fagots ? Et on comprend tout de suite qu’on a affaire à du très très haut niveau quand Célia Kameni entame tout de go a capella The secret life of plants, d’une justesse que l’on constatera tout simplement parfaite quand les premiers arpèges s’égrènent sur le piano. L’entrée en lice de la section rythmique ne se fait pas attendre, on remarque au passage quelques doubles croches en rim-knock. Du grand art. La grille est bien là, plus fournie que l’original, les accords sont opportunément enrichis, ouvrant un boulevard à d’autres développement dont ni Alfio Origlio ni Célia Kameni ne se prive. Le morceau se termine par une coda qui s’étire jusqu’à s’éteindre progressivement.
Après un passage du côté des Beatles, Caravan est la première grande claque retentissante de la soirée. L’impro piano du départ chatouille bien les oreilles, on reconnaît mais on n’identifie pas, jusqu’à une petite phrase de quatre ou cinq notes après laquelle il n’y a plus de doute possibles. La caravane prend des allures de TGV, les chorus de contrebasse et de batterie sont éblouissants comme le soleil du désert.
No love dying, de Gregory Porter, ramène le calme et nous raconte qu’en amour, l’espoir n’est jamais perdu pour peu qu’on sache s’en saisir. La batterie se joue avec les mains, les chorus sont mélodiques et sensibles. On joue sur le plus soyeux des velours, prélude à la plus inattendue des chansons de ce set : Le blues indolent, qu’interprétait naguère Jeanne Moreau. Intro délicieuse sur laquelle viennent se poser subtilement les premières paroles, comme un secret partagé à demi-mot : « Je suis indolente, mes yeux sont vagues vagues vagues, Je balance mes hanches vaguement, ……….. Les jeux de l’amour sont comme les jeux de hasard ….. ». On se laisse bercer par cet air, par ce refrain, sans prendre garde à la montée en puissance du trio instrumental qui vous envahit inexorablement jusqu’au paroxysme au-dessus duquel s’envole la voix de Célia Kameni, du plus grave au plus aigu, ample, chaleureuse, soutenue par cette gestuelle qui la caractérise par laquelle elle signifie au public le cadeau qu’elle lui fait de ce partage de ses émotions, jusqu’à nous donner le frisson.
On tape dans les mains pour se ressaisir et faire la place à Master Blaster, qui prend des couleurs funky qui lui siéent à merveille, pour terminer par une longue coda qui renoue avec le reggae de l’original.
Qui l’eût cru ? Jimi Hendrix est de la partie avec Purple Haze bien déjanté, enchaîné à la volée par Afro Blues tout en envoûtante ambiance africaine de circonstance, installée par la complicité de Brice Berrerd et Zaza Desiderio, l’un répétant à l’envi un ostinato entêtant, l’autre imprimant à la main des rythmes africains pur jus. Les chorus collent à l’ambiance, le scat se fait onomatopées et rythmes sur deux ou trois notes, piano et batterie partent sur le chemin déroutant des cadences hétéroclites pendant que, droit dans ses bottes, Brice Berrerd tient la baraque sans dévier d’un poil de sa cadence. Zaza Desiderio s’envole dans les hautes sphères de la polyrythmie, tandis que son pied gauche sort des combinaisons inédites du charleston sur un tempo vissé à la contrebasse. Célia Kameni reprend le thème pour conclure en éliminant une à une, mais pas dans l’ordre, les notes de la mélodie.
En rappel, le quartet interprète Goldfinger, tout nouvellement inscrit au répertoire, que double zéro sept ne renierait pas.
Il est temps de tendre l’autre joue ……