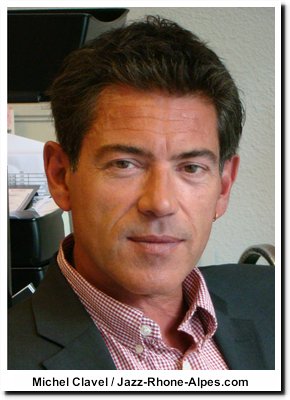Divines divas
Alléchant co-plateau proposé par le festival Voix d’Autres Continents pour ce week-end pascal, la soirée de samedi réunissait au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin (CCCCC), comme au bon vieux temps de A Vaulx Jazz, deux voix féminines exceptionnelles. Avec côté découverte la révélation de la majestueuse Kareen Guiock-Thuram dans un répertoire hommage à Nina Simone qui légitime pleinement son propre talent, et les retrouvailles avec la grande Sarah McCoy qui revient en trio pour un inattendu concept habillé de sons électroniques. Deux divas divines, le jour avant la nuit, tant l’une a illuminé son set de son charisme solaire, quand l’autre à l’aura plus sombre nous aura plongé dans la noirceur de son univers. Mais deux grandes dames sincères et naturelles pour nous toucher singulièrement.
Ceux qui regardent le JT de 12h45 sur M6 connaissent cette journaliste présentatrice qu’on a pu voir précédemment dans le magazine Turbo. Et les fans de foot n’omettront pas de relevé dans son nom celui de son champion du monde de mari. Mais la belle femme de quarante sept ans titulaire d’une maîtrise de philo, n’est pas que fan de bagnoles ou de kung fu ! Celle qui se définit comme «une vieille chanteuse qui débute» écume en effet depuis déjà une quinzaine d’années les clubs jazz de la capitale pour assouvir, pour le fun et en toute humilité, cette autre passion viscérale en compagnie du pianiste et compositeur Dominique Fillon. C’est lui qui l’an dernier a poussé Kareen Guiock-Thuram, dont la culture s’est nourrie depuis toujours de jazz, de rap et de R&B américain, a faire une pause médiatique de neuf mois, temps de gestation pour accoucher d’un vrai projet pro. Un premier album sobrement intitulé «Nina», alignant onze reprises emblématiques de l’icône Nina Simone, agrémenté de trois interludes écrits par Kareen, narrant quelques étapes de celle en qui elle trouve un modèle de femme noire et engagée, courageuse militante en plus d’être une artiste fondamentale.
Une irréprochable légitimité
Alors bien sûr, et après que tant d’autres se soient déjà attaqué à un tel sommet, pourrait se poser la question de la légitimité. A l’écoute de l’album, où elle est entourée du gratin avec Raphaël Chassin et Laurent Vernerey, cette question devient d’évidence indécente. Quelle voix ! Quel grain ! comme fait pour cela, avec spontanément toutes les nuances requises. Surtout, avec une appropriation très personnelle, sans jamais tomber dans le mimétisme ou pire, l’imitation.
Et c’est bien ce talent nouveau et cette classe naturelle qui resplendissent en live dès l’entame du concert où Kareen est là encore entourée d’un trio de pointures adéquates avec Kevin Jubert aux pianos acoustique et électrique, et les brillants rythmiciens Tilo Bertholo aux drums et Rody Cereyon à la basse. Après une Leçon d’être en prélude délivré en voix off, Nobody’s fault but mine nous met d’emblée au parfum avec un chant mat et profond, une diction aussi limpide que le groove distillé par les trois garçons est fluide, et déjà en prime un beau chorus de basse à la Marcus Miller.
« Nina est un chemin, celui d’une femme engagée pour l’égalité et la justice. Un chemin où l’on va traverser ses colères mais aussi ses espoir » explique la chanteuse pour introduire le plus bluesy How it feels to be free d’obédience gospel.
Le piano jazzy fait swinguer Mississippi Goddam et chauffe le public avant que ne tombe l’un des titres les plus mythiques, le fabuleux I put a spell on you. Un sommet gravi sans fioritures ni manières, marque de fabrique visiblement d’une Kareen Guiock-Thuram au naturel, évitant tous les tics et autres surjeux dans lesquels tant d’autres ont glissé en interprétant ce monument. Magnifique dans sa robe noire et réhaussant encore ses longues jambes de mannequin par des talons aiguilles, la fan de gwoka guadeloupéen se lance alors dans une danse tribale, emportée par la mélodie alerte du piano et la frappe très percussive de Tilo sur ses tambours qui emmènent sur un rythme de plus en plus endiablé Sinnerman vers une transe latino.
Chaude parenthèse avant de revenir aux fondamentaux avec en enfilade les standards Feeling good, livré tout en finesse par le trio au groove feutré et où le chant se fait de plus en plus sensuel pour ne pas dire sexuel… Puis My baby just cares drivé par une belle promenade pianistique où la basse tricote ses notes timbrées. Une rondeur ouatée de la cinq cordes parfaite pour faire chanter ses chorus, et une même finesse sur les claviers que l’on retrouve sur l’inévitable Ne me quitte pas qui suit. J’ai déjà eu maintes fois l’occasion de dire combien je n’ai jamais été conquis par cette reprise quasi panthéonisée de Nina Simone. Et pour avoir vu quelques très grandes divas se vautrer depuis sur cette chanson particulière que, à mon sens, seul Brel pouvait chanter, c’est sans doute là que j’attendais le plus au tournant l’interprète de ce soir.
S’il ne sera pas le meilleur moment de ce répertoire, avouons que, bien que parfois sur le fil en termes de justesse, la charismatique et sincère Kareen s’en tire plutôt bien sur ce titre toujours aussi casse-gueule.
Seule avec le piano pour un petit interlude sur la Diva où même parlée sa voix chaleureuse enveloppe l’auditoire, c’est à l’inverse sur le sublissime I Love you Porgy que l’artiste atteint son acmé. Une version dépouillée du meilleure effet, le délié sonnant du piano portant à la perfection toute la sensualité dégagée par la chanteuse. L’écoute est religieuse dans le public totalement sous le charme de ce moment suspendu, prolongé dans la foulée par Mr Bojangles, une autre pépite au super feeling où la voix rayonne de toutes ses nuances sur un groove délicatement tamisé.
Après un Seeline woman qui clôt le set là encore dans une version bien différente de toutes celles qu’on a pu déjà entendre, le tubesque Love me or leave me est offert en rappel où le speed de son swing fait claper le public une dernière fois, aussi vibrionnant que le solo de batterie offert par Tilo.
Sans esbroufe mais avec une maîtrise technique imparable, la musicalité innée de Kareen Guiock-Thuram ajoutée à sa présence solaire trouvent en Nina Simone le registre idoine pour révéler une «future» grande, pour peu que la jazzwoman si bien entourée poursuive sur cette superbe lancée avec des compos originales cette fois. On a hâte !
Sarah is back !
Autre grande dame à l’affiche ce soir de ce costaud co-plateau, on retrouve avec plaisir l’immense Sarah McCoy qu’on ne présente plus et qu’on avait laissée il y a déjà quelques saisons après avoir été renversé par la force rédemptrice de son blues livré en piano solo. Hasard -ou pas-, on se souvient notamment, outre ses propres compos inspirées de son douloureux parcours de vie, de ses déchirantes reprises de quelques titres emblématiques de Nina Simone, entendus juste avant avec Kareen Guiock-Thuram .
Mais c’est bien éloignée de cet univers, tout du moins sur le plan musical, que l’excentrique et touchante Sarah nous revient, cette fois escortée du batteur machiniste Antoine Kemino et du bassiste -clavier basse Jeffrey Hallam. Basses profondes, sons synthétiques, beats sur batterie électronique, c’est un nouvel univers aux textures inattendues qu’elle a composé avec le non moins barré Chilly Gonzales pour son second album «High Priestess» que j’avoue découvrir pour la première fois ce soir.
Sacrée Sarah, toujours aussi incroyable, exubérante et fascinante comme dès l’intro seule au piano, très théâtrale. Une fois le trio réuni pas de doute, c’est bien dans l’électro-pop que nous emmène ce nouveau format, jouant des dissonances qui, comme le rappelle la chanteuse qui s’efforce de parler en français malgré quelques « fucking » disséminés ça et là, «apportent parfois beaucoup de beauté à la musique». Ce qui n’empêche pas ce répertoire plus audacieux de ménager des tendances de R&B ou des ballades dans l’esprit pop-rock, certes avec d’étranges ambiances parfois distillées par le gros son du synthé basse.
Avec la flamboyante Sarah, ogresse fellinienne, on est toujours dans une sorte de tragi-comique. Ses textes portent toujours la gravité de son passé, sa voix exceptionnelle laisse toujours percer les douloureuses fêlures qui l’ont marquée, et pourtant ses interventions pour expliquer le contexte sont d’une telle désarmante franchise qu’elles virent souvent au sketch délirant qui fait éclater de rire l’auditoire. Spontanée, sans filtre ni complexe, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.
Mais le rire a ses limites, surtout quand comme le sien il se fait sardonique et hâbleur, comme pour mieux masquer les douleurs ou les angoisses rentrées. On les ressent particulièrement quand elle exhume de son précédent récital deux titres emblématiques, ce Boogieman terrifiant croquemitaine de ses cauchemars d’enfant, ou bien sûr Mamma’s song où elle écrit à sa mère pour se faire pardonner de ses frasques et s’en repentir. Une version habillée d’un traitement électro qui participe de concert à l’émotion distillée, longue, intense et déroutante, tel un bad trip de plus de dix minutes, ambient et quasi psychédélique, assurément sombre comme le blues qui s’est fait de plus en plus dark pour en arriver là. C’est d’ailleurs par un noir complet du plateau que les dernières notes s’envoleront avant que le trio s’éclipse, sans rappel possible après pareil moment.