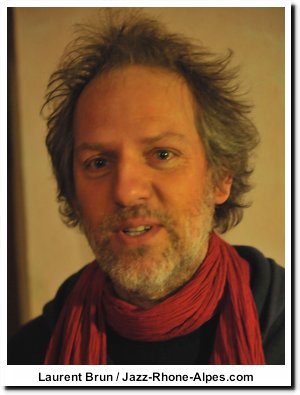Les temps changent. Le ciel s’obscurcit. Davantage. On ne peut que constater les effets pervers du système capitaliste poussé à outrance, et le vacillement de toutes les valeurs qui supportaient jusqu’ici les sociétés occidentales. Les états, devant les dégâts humains et écologiques, plutôt que de servir de digue, préfèrent renforcer leur autoritarisme, et se fascisent à tous les niveaux. Les institutions sont piétinées, justice, éducation… L’expression démocratique passe par le pis-aller des réseaux sociaux où le commun des mortels croit avoir atteint le Graal de la liberté alors qu’il n’a fait que la vendre aux grandes sociétés marchandes qui les manipulent. En France, les médias mainstream tenus par des milliardaires orientent les consciences. La haine de l’autre devient le seul horizon pour faire union. Toute pensée qui dévie du consensus devient suspecte. Les valeurs se retournent : on devient antisémite parce qu’on dénonce la violence d’Israël, on devient élitiste quand on s’insurge contre la consommation de masse. On est traité de dinosaure quand on ose dire que l’intelligence artificielle n’est pas la solution. Toute pensée critique devient obsolète. Toute pensée critique est arrêtée avant qu’elle n’ait déployé sa dialectique.
Que peut l’art dans tout ça ? Peut-il encore quelque chose ? Dans le tout marchandise, il est prêt aussi à vendre son âme. Si on peut me rétorquer qu’un artiste a lui aussi besoin de vivre et que l’art est un marché, il n’empêche que seul l’art est capable de nous éloigner de notre soif d’égo et de domination. Seul l’art est capable de nous permettre une distance salutaire entre nous et nos actes, l’art comme miroir de nos agissements et de nos névroses. Si l’artiste était seulement un être vénal, nous n’aurions pas connu, depuis les dessins pariétaux jusqu’à l’art d’aujourd’hui, tous les trésors plastiques qui font le génie de notre humanité, plaidoyer pour ses forces et ses faiblesses. Il est regrettable que certains aient été pauvres leur vie durant, cela n’a pas été le moteur de leur inspiration, mais bien cette volonté de faire jaillir la création au-delà de la réalité qu’ils enduraient (pour ne prendre que deux exemples dans des domaines différents, Van Gogh ou encore Erik Satie). L’art est toujours interrogation sur le réel et la source de possibles meilleurs.
Que nous dit l’état de la société aujourd’hui quand on voit comment l’art est traité ? Je ne parlerai pas ici du marché de l’art, celui qui joue des sommes colossales et qui défiscalise en investissant sur les artistes à la mode qui rapportent. Je prendrai juste quelques exemples, plus modestes, dans le domaine du jazz.
Prenons l’économie d’un festival, disons un grand festival. Prenons quelqu’un de critique, par exemple, un journaliste. Que verrait-il de l’extérieur ? Quelles constatations pourrait-il faire ? Il voit des concerts comme de grandes cérémonies, avec affluence, qui attirent un public toujours plus nombreux, orienté, via de grandes voies publicitaires, à consommer toujours plus de spectacles, de boissons et de nourriture. L’objectif pour le festival est de remplir. Le discours autour de ce remplissage est basé sur le fait que des vedettes consensuelles, à la mode, coûtent cher et qu’il faut rentabiliser. L’argument ultime vantera les retombées économiques sur la ville, l’agglomération, la région. L’objectif final est la croissance à tout prix.
Qu’en retire le spectateur lambda ? Certes, il faudrait le lui demander, mais selon moi, cela ne dépasse pas le plaisir immédiat et éphémère. Il manque ici à l’art sa fonction politique. Ce que Jacques Rancière nomme le partage du sensible, cet espace (politique, mental), pour examiner et critiquer « ce qu’il y a à y faire, à nommer, à voir» et à améliorer pour un futur meilleur. Un festival est très souvent privé de cette vision, lui préférant une débauche de divertissements. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que dans une logique pareille les journalistes, écrivains et photographes, aient de plus en plus de mal à être reconnus dans leur travail, surtout bénévole. Actuellement, dans ces grandes cérémonies, on demande à un photographe d’être discret, au point de lui accorder quelques photos sur les trois premiers morceaux du concert, quand ce n’est pas sur le premier, ou tout bonnement de lui demander d’aller se rhabiller s’il ne donne pas le fruit de son travail à la production. Il y a encore quelque temps, ce même photographe avait le droit de se balader dans les coulisses, d’assister aux balances, d’interroger le jazz dans ses marges. Que serait le travail photographique sur le jazz sans la vision d’un Guy Le Querrec par exemple, ou encore d’un Pascal Kober, plus proche de nous, ou d’autres, dont l’art justement était de se glisser là où on ne les attend pas. Ces photos, non contraintes, ont fait beaucoup sur la connaissance des artistes et de leur œuvre. Elle captait l’humain sous l’icône, le fébrile sous le mythe. Elles rapprochaient l’œuvre de son public. Elles tentaient d’interroger le réel, le contexte. Elles dénonçaient sans le vouloir, critiquaient sans l’annoncer. Le journaliste écrivain fait de même. En rendant compte dans un festival des concerts, il ne parle pas simplement du temps qu’il fait et du nombre de spectateurs présents, il reconnecte l’œuvre au contexte, et tend à dénicher ses délicatesses et ses subtilités et leurs impacts sur ce contexte même.
Quand un festival interdit aux journalistes, même bénévoles, d’exercer leur activité, en les contraignant, c’est bien entendu un non-respect du travail, mais c’est surtout tout un pan de la pensée qui est bafoué et qu’on ne veut pas voir et entendre. Qu’y a-t-il actuellement de plus important pour un festival, c’est de donner des accréditations à des youtubeurs qui, loin d’avoir une réflexion sur ce qu’ils voient, vont simplement être des influenceurs, c’est-à-dire des publicitaires, pour leurs quelques milliers de followers. Au final, c’est l’art qu’on contraint et ce sont les artistes eux-mêmes qui se font rouler dans la farine parce que leur discours émancipateur n’est plus audible.
Pas étonnant que dans une société où seul le produit compte, on n’ait plus besoin d’une activité critique, comme dans un autre domaine, on n’a plus besoin de fonctionnaires, de juges, d’enseignants… Chacun donnera son opinion, réduite à peau de chagrin, par un like. Et le conformisme se répétera. Et la révolution attendra.
Aujourd’hui, il devient urgent « d’organiser le pessimisme », pour reprendre une formule de Walter Benjamin. En son temps, il avait déjà vu les premiers dégâts de la révolution industrielle et de l’ère de la consommation qui apportait son lot de consternation. Il avait déjà senti les effets néfastes du capitalisme et les liens qui se tissaient avec le fascisme. Contre les bruits de bottes et la montée de l’intolérance, l’art peut encore si, non seulement on lui accorde du crédit spirituel, mais aussi si on arrête de le contraindre. Les artistes (mais également vous, moi) avons des ressources pour combattre et imaginer un futur prometteur. L’humour, la dérision sont des armes qui véhiculent souvent bien plus avantageusement et profondément un message sensible et politique. À en juger par le travail de l’artiste de jazz Pierrejean Gaucher, artiste brillant et sensible, qui met son art à l’épreuve du réel avec ses vidéos branchées sur l’actualité politique.
J’ai parlé de l’économie des festivals, on pourra aussi évoquer la politique de certaines salles de spectacle qui se laissent de plus en plus envahir par la tentation de refouler les journalistes, sous des prétextes de plus en plus fallacieux, se retranchant, pour les plus grandes salles, derrière la volonté des productions. Quand on interroge l’artiste en direct (car il existe bien un lien, de passage, entre l’artiste et le journaliste), il dit ne pas être au courant et consterné par cet état de fait.
J’en appelle à tous les musiciennes, musiciens et autres artistes d’autres domaines à ne pas se faire dévorer par leur production, par toute politique qui les dépossède de leurs messages qu’ils ont à partager.
Sinon nous finirons benêts, confits dans le divertissement, la bière et la mal bouffe, béats mais non libres.