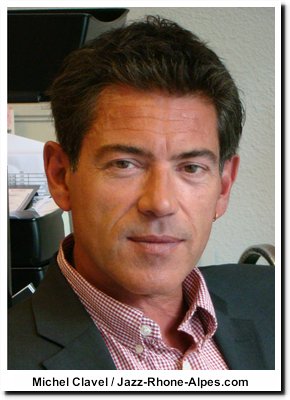Sons du Monde
Nous poursuivons notre périple parmi les nouveautés en matière de musiques sans frontières, avec un hommage au percussionniste Nana Vasconcelos signé par Fred Soul et Ze Luis Nascimento, figure du Brésil d’où provient aussi Itiberê Swarg, chef d’orchestre complice d’Hermeto Pascoal qui a piloté un vaste projet dans l’esprit de l’inventeur de la «musica universal» avec un grand ensemble de musiciens parisiens. La chanteuse et violoncelliste new-yorkaise d’origine haïtienne Leyla McCalla revient quant à elle à son meilleur dans un album de pop-world particulièrement accrocheur, et l’on découvre le talent de l’italo-français Giuliano Gabriele, chanteur et accordéoniste fougueusement engagé dans un album dissident et puissant où résonnent les rythmes cathartiques du Sud de l’Italie. Autant de sons du monde particulièrement vibratoires !
FRED SOUL – ZE LUIS NASCIMENTO «Viva Nana» (Barkhane Productions / L’Autre Distribution)
 Poly-instrumentiste et rythmicien virtuose (piano, percussions, melodica, flûte alto) le producteur Fred Soul qui nous a scotché l’an dernier avec le sublissime album «Njaboot» de Julia Sarr revient aujourd’hui associé au grand percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento pour rendre hommage à leur illustre homologue Nana Vasconcelos décédé en 2016. Originaire de Récife, ce maître des percussions qui puisait dans les éléments de la nature les nutriments de ses sons aura laissé son empreinte exceptionnelle en travaillant avec des artistes aussi divers que Gilberto Gil, Art Blakey, les Talking Heads, Pierre Barouh ou Pat Metheny, entre autres.
Poly-instrumentiste et rythmicien virtuose (piano, percussions, melodica, flûte alto) le producteur Fred Soul qui nous a scotché l’an dernier avec le sublissime album «Njaboot» de Julia Sarr revient aujourd’hui associé au grand percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento pour rendre hommage à leur illustre homologue Nana Vasconcelos décédé en 2016. Originaire de Récife, ce maître des percussions qui puisait dans les éléments de la nature les nutriments de ses sons aura laissé son empreinte exceptionnelle en travaillant avec des artistes aussi divers que Gilberto Gil, Art Blakey, les Talking Heads, Pierre Barouh ou Pat Metheny, entre autres.
Comme lui, ses deux disciples se font sourciers pour explorer à leur tour le champ d’improvisation et faire jaillir tout ce qui peut relever de la pulsation de la vie, mettant la science du rythme au service du chant du monde, ici en compagnie de divers invités de renom conviés au gré des titres.
Passé le titre éponyme en ouverture au piano et cordes superbes, le très rythmé et explicite Dantza croisant percussions et voix sur un ostinato de piano invite à la danse, sur une orchestration presque symphonique de l’ensemble où l’on trouve Chico Cesar au chant, le souffle en liberté de Robinson Khoury au trombone et la fine guitare d’ Anthony Jambon en chorus. Odara Xiré, compo en deux parties, reflète totalement l’esprit de Nana Vasconcelos, très percussif tout en façonnant un univers étrange de jungle, presque inquiétant, entre le souffle envoûtant de la flûte et celui des voix, comme tribal, proche des incantations indiennes. Plus lumineux, tel une renaissance guillerette, Les Cendres du Paradis convoque l’accordéon de Vincent Peirani et la flûte de Sylvain Barou sur un piano alerte qui n’empêche pas la douceur des voix de nous enchanter. Plus encore, cette douceur se fait voluptueuse sur la superbe ballade de Continuum avec son thème aérien porté par le triptyque voix/piano/percussions et où le guitariste cisèle son doigté comme à son habitude.
Après un retour aux rythmes afro-caribéens avec Ayé Nana, plus tribal et répétitif, la longue intro d’Uxörem Ducere place le piano en majesté entre classique et jazz, avant qu’un break où réapparaît l’accordéon plus assombri de Peirani ne le teinte de mélancolie. Parmi les pépites de cet album qui sera dans les bacs le 26 avril prochain, on fond encore sur les deux derniers titres, le plus long Zeru Zeru et son beau montage vocal où l’on a plaisir à retrouver toute la magie du grain de Julia Sarr mêlé à celui de To Brandiléone, un titre atmosphérique où sonne la contrebasse de Chris Jenning, puis en merveilleux final comme suspendu, le court Juvenal sensuel et touchant, mariant voix en talk-over et accordéon.
LEYLA McCALLA «Sun without the Heat» ( ANTI / PIAS)
 Si je n’avais pas été séduit par son «Breaking The Thermometer» paru il y a tout juste deux ans et où le discours politique prenait trop le pas sur la musique, ce cinquième album studio de Leyla McCalla paru ce week-end convainc nettement plus en s’écoutant avec un évident plaisir. La chanteuse et violoncelliste d’origine haïtienne, née dans le Queens de New-York d’un couple d’émigrants activistes, y élargi sa palette musicale en revisitant ses influences créatives (Haïti, le Ghana, la Louisiane où elle avait rencontré Raphaël Imbert avant de participer à son « Music is my Home ») dans un esprit plus léger et ludique qui inscrit ces dix nouveaux titres dans une plus large pop-world aux sonorités accrocheuses. Un album né d’une session intense de neuf jours au Dockside Studies de la Nouvelle Orléans sous la férule de la productrice Maryam Qudus qui tient les synthés et l’orgue aux côtés des coéquipiers habituels de Leyla avec Pete Olynciw à la basse et au piano, Shawn Myers à la batterie et Nahum Zdybel aux guitares. Un processus nouveau où tout s’est construit ensemble et en temps réel pour donner lieu à une liste de chansons transcendantes, du chagrin à la joie, de l’obscurité à la lumière.
Si je n’avais pas été séduit par son «Breaking The Thermometer» paru il y a tout juste deux ans et où le discours politique prenait trop le pas sur la musique, ce cinquième album studio de Leyla McCalla paru ce week-end convainc nettement plus en s’écoutant avec un évident plaisir. La chanteuse et violoncelliste d’origine haïtienne, née dans le Queens de New-York d’un couple d’émigrants activistes, y élargi sa palette musicale en revisitant ses influences créatives (Haïti, le Ghana, la Louisiane où elle avait rencontré Raphaël Imbert avant de participer à son « Music is my Home ») dans un esprit plus léger et ludique qui inscrit ces dix nouveaux titres dans une plus large pop-world aux sonorités accrocheuses. Un album né d’une session intense de neuf jours au Dockside Studies de la Nouvelle Orléans sous la férule de la productrice Maryam Qudus qui tient les synthés et l’orgue aux côtés des coéquipiers habituels de Leyla avec Pete Olynciw à la basse et au piano, Shawn Myers à la batterie et Nahum Zdybel aux guitares. Un processus nouveau où tout s’est construit ensemble et en temps réel pour donner lieu à une liste de chansons transcendantes, du chagrin à la joie, de l’obscurité à la lumière.
Un chemin ouvert par Open the road, pop au son rock par sa guitare et son drumming, mais aux mélodies plus world-music, puissant à l’instar d’une Ilene Barnes. Les sonorités des musiques traditionnelles afro-caribéennes prennent le dessus sur Scaled to survive, ritournelle charmeuse dans la douceur de petites percussions et où la clarté de la voix comme des cordes resplendit, le grave du violoncelle accentuant l’aspect romantique. Entre Afrique et Orient, Take me away nous entraîne dans une tournerie répétitive et dansante, avec en final une belle chorale. On adore les nuances jazzy, fines et puissantes de la voix sur le tempo bluesy de So I’ll go, planerie assez psyché au son d’une pop aérienne et d’une magnifique incandescence dans son crescendo.Sur une guitare et une rythmique plus ibérique, la voix rayonne encore de pureté sur la ballade Tree, très étirée sur six minutes, mais avec en son cœur un passage totalement free et fou, avec guitare et batterie complètement débridées qui laisse pantois pour ne pas dire K.O… On s’en remet par le calme du titre éponyme où la douceur folk de ce guitare-voix agit telle une berceuse.Mais la pop-rock revient vite avec Tower, entre chorus de guitare à effets et caisse claire «tangotante» qui me fait encore penser à Ilene Barnes. Un esprit du fameux mélange entre pop-rock et world-music qui a marqué les 90’s avec un son tubesque qui donne envie de danser. Nettement plus dépouillé, et toujours dans cette alternance de titres très énergiques et de ballades, on est tout autant charmé par l’ambiance du folk des îles retrouvé sur Give yourself a break que par le superbe I want to believe qui clôt ce bel opus sur les résonances mélancoliques du piano croisé au grave du cello.
GIULIANO GABRIELE «Basta!» (Coming Musicart / Inouïe Distribution)
 Derrière la pochette mystérieuse figurant des personnages masqués intrigants, on découvre Giuliano Gabriele, chanteur et accordéoniste italo-français, un auteur-compositeur considéré comme l’un des artistes les plus en vogue de la scène world d’Italie déjà lauréat de nombreux prix en la matière. L’explicite «Basta!» paru tout récemment est un album de dissidence racontant les frustrations et les peurs d’individus emprisonnés dans nos systèmes contemporains, un fond engagé livré par une forme qui l’est tout autant, sous la férule de l’éclectique producteur Martin Meissonnier (ici aux programmations) qui a déjà oeuvré pour Fela, Khaled, Manu Dibango,Tony Allen, Papa Wemba côté musiques afros, mais aussi avec Alan Stivell ou encore Page et Plant de Led Zep. Un détonnant métissage des rythmes cathartiques du Sud de l’Italie et ses cadences traditionnelles particulièrement intenses, avec d’autres musiques du monde méditerranéen, dans la puissance d’un rock enivrant.
Derrière la pochette mystérieuse figurant des personnages masqués intrigants, on découvre Giuliano Gabriele, chanteur et accordéoniste italo-français, un auteur-compositeur considéré comme l’un des artistes les plus en vogue de la scène world d’Italie déjà lauréat de nombreux prix en la matière. L’explicite «Basta!» paru tout récemment est un album de dissidence racontant les frustrations et les peurs d’individus emprisonnés dans nos systèmes contemporains, un fond engagé livré par une forme qui l’est tout autant, sous la férule de l’éclectique producteur Martin Meissonnier (ici aux programmations) qui a déjà oeuvré pour Fela, Khaled, Manu Dibango,Tony Allen, Papa Wemba côté musiques afros, mais aussi avec Alan Stivell ou encore Page et Plant de Led Zep. Un détonnant métissage des rythmes cathartiques du Sud de l’Italie et ses cadences traditionnelles particulièrement intenses, avec d’autres musiques du monde méditerranéen, dans la puissance d’un rock enivrant.
Dès l’intro avec le titre éponyme on est saisi par la voix abrasive de Guiliano Gabriele et son accordéon diatonique lancinant, le rythme soutenu par la batterie de Riccardo Bianchi et le tambourin d’Eduardo Vessella sur la ligne de basse de Gianfranco De Lisi, où vont se croiser les cordes de l’alto et de la lyre calabraise joués par Lucia Cremonesi et la guitare électrique de Giovanni Aquino.
On pense bien sûr à un groupe comme Crimi dans ce pont lancé entre Sicile et Maghreb avec le plus orientalisant Non Ci Credi, toujours martelé dans un esprit très rock où l’on ressent sous le chant incandescent couver un feu latent. On aime la patte résolument plus pop de Sabir où l’on retrouve à la fois un rythme de danse trad’ et la couleur typique de la chanson rock italienne, avec une basse qui groove sur cette belle mélodie chantonnée par l’alto émouvant. Du groove qui s’affirme encore plus dansant sur Muoviti et son refrain entraînant, patchwork de musiques du monde entre afro, reggae et couleur des îles. Paroles d’engagé et paroles d’enragé, comme pour ce mot d’ordre Réveillez-vous! en français dans ce texte chanté en italien, slow puissant et habité émettant de belles nuances notamment via les cordes de l’alto. Une fougue inaltérée dans le chant et les rythmes, toujours bien présente pour Mammasantissima où l’on ressent l’urgence dans les mots comme dans les notes sur ce titre où l’accordéon nous embarque dans une spirale enflammée, haletant tourbillon porté par une ligne de basse bien timbrée. Un souffle d’engagement qui passe par la voix déchirante du leader dans In Silenzio et toujours par des rythmes très soutenus comme encore dans Razza Riace, pop enivrante où le break de guitare fait penser par ses sonorités à un Robert Plant.
ITIBERE ORQUESTRA FAMILIA DA FRANCA «Live in Paris» ( TUI TUI / Inouïe Distribution)
 Conçu durant la pandémie des deux côtés de l’Atlantique par Itiberê Zwarg et le saxophoniste français Benoît Crauste, l’Orchestra Familia da França est un projet instrumental unique dont la première a eu lieu en janvier 2022 à Paris. Itiberê est un multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur, chef d’orchestre brésilien qui depuis 1978 est, en tant que bassiste, le complice principal de l’inventeur de la «musica universal» Hermeto Pascoal. Un langage musical original qui bouscule les codes habituels et dont les racines puisent dans les folklores du Brésil comme dans le jazz ou toutes les formes et styles qui se prêtent à son inspiration libre, sans aucune limite. Accompagné par son fils Ajurina, également batteur de Hermeto Pascoal, et de sa fille autiste Mariana (flûte, piccolo), ils sont venus en France pour diriger pas moins de dix neuf instrumentistes parisiens lors d’une résidence organisée entre autres par le festival Sons d’Hiver. Un ambitieux projet d’échange culturel et un intense processus créatif qui a donné lieu à quelques concerts enregistrés et restitués aujourd’hui dans ce Live in Paris.
Conçu durant la pandémie des deux côtés de l’Atlantique par Itiberê Zwarg et le saxophoniste français Benoît Crauste, l’Orchestra Familia da França est un projet instrumental unique dont la première a eu lieu en janvier 2022 à Paris. Itiberê est un multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur, chef d’orchestre brésilien qui depuis 1978 est, en tant que bassiste, le complice principal de l’inventeur de la «musica universal» Hermeto Pascoal. Un langage musical original qui bouscule les codes habituels et dont les racines puisent dans les folklores du Brésil comme dans le jazz ou toutes les formes et styles qui se prêtent à son inspiration libre, sans aucune limite. Accompagné par son fils Ajurina, également batteur de Hermeto Pascoal, et de sa fille autiste Mariana (flûte, piccolo), ils sont venus en France pour diriger pas moins de dix neuf instrumentistes parisiens lors d’une résidence organisée entre autres par le festival Sons d’Hiver. Un ambitieux projet d’échange culturel et un intense processus créatif qui a donné lieu à quelques concerts enregistrés et restitués aujourd’hui dans ce Live in Paris.
Seulement cinq titres y figurent, mais là encore suffisamment intenses pour rassasier ceux qui aiment vibrer aux sons d’un jazz résolument très contemporain, titres aux intitulés étonnants qui reflètent les impressions ressenties par Itiberê lors de ses précédentes tournées en France avec Hermeto Pascoal. Ainsi d’Annecy étiré à plus de dix minutes qui ouvre l’opus et où cordes puis cuivres et percussions dévoilent d’emblée la luxuriance d’un vaste ensemble de musique mi-sympho mi-contemporaine. Un sentiment de profusion où la voix de Sophie Rakotomalala s’inscrit résolument dans le jazz moderne.Une compo longue qui prend du nerf tendance jazz-rock par le drumming appuyé d’Ajurina, la ligne de basse de Yann-Lou Bertrand et le Fender Rhodes de Vincent Jacqz. Puisant à diverses sources, ça part dans tous les sens et les non-initiés devront sans doute s’accrocher!
L’ambiance est posée, on est alors plongé dans le chaudron d’un concert de grand ensemble où toute la famille des cuivres en particulier s’en donne à cœur joie, sax et trompettes prenant tour à tour la main sur des rythmes variés et virevoltants, dans l’esprit d’un jazz contemporain très chantant. Toujours entre classique symphonique et jazz audacieux, Chegando Em Paris reste dans l’esprit big-band, le toucher d’accordéon et de xylophone de Pedro Francisco apportant la touche brésilienne. Une touche clairement identifiée encore par le scat de la chanteuse sur La Fête des Gaulois, voix haut perchée à l’instar des sonorités des flûtes et autres piccolos sur ce titre qui tombe sacrément avec sa rythmique intense, et fait penser à un vaste conte musical façon Amazing Keystone mais qui serait frappé comme c’est particulièrement le cas dans le final, par une folie toute magmaïenne. Une folie identifiable que l’on retrouve enfin sur Grenoble, dernier des titres où l’ensemble se débride de plus en plus en totale liberté et avec beaucoup d’aisance. Et ce n’est pas parce qu’il a été baptisé du nom d’une ville de notre région que l’on apprécie particulièrement ce titre où les cuivres rutilent et où les solistes minaudent sur un Fender Rhodes bien timbré. On aime ces belles attaques fougueuses, dans l’esprit de certains génériques de séries des années 70’s, qui mettent assurément la patate. Audacieux, intense et revigorant, bien à l’image de cette vibrante armada de talents. Cela ne dure au total que trente cinq minutes, mais attention les oreilles !…