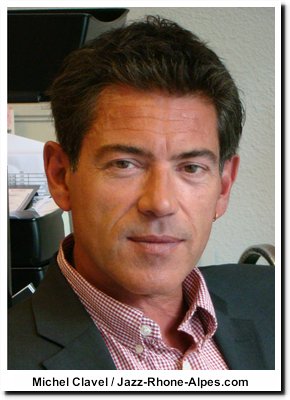Les repérages de l’été (2/3)
Une sélection estivale éclectique où règne la séduction, avec la résurrection miraculeuse d’un inédit de George Benson enregistré en 1989 sous les orchestrations luxuriantes de Robert Farnon, la découverte de la chanteuse et pianiste d’origine serbe Katarina Pejak et son blue-folk sensuel et groovy, le charme rétro de March Mallow et son jazz vocal à l’ancienne, mais aussi le retour aux sources d’un jazz nomade et très contemporain pour le EYM trio.
GEORGE BENSON «Dream do come True» (Rhino/ Warner)
 Si les miracles sont souvent difficiles à croire, surtout quand ils représentent un beau coup marketing, ce nouvel album du géant George Benson qui signe à l’occasion son retour chez Warner via le mythique label californien Rhino, est de ceux-là. En effet, les bandes de cet opus enregistré en 1989 alors que le maître était encore très prolifique, ont semble-t-il été égarées (!) jusqu’à ce que le chanteur-guitariste les retrouve dernièrement au fond d’un tiroir de ses archives, pas moins de trente-cinq ans plus tard !
Si les miracles sont souvent difficiles à croire, surtout quand ils représentent un beau coup marketing, ce nouvel album du géant George Benson qui signe à l’occasion son retour chez Warner via le mythique label californien Rhino, est de ceux-là. En effet, les bandes de cet opus enregistré en 1989 alors que le maître était encore très prolifique, ont semble-t-il été égarées (!) jusqu’à ce que le chanteur-guitariste les retrouve dernièrement au fond d’un tiroir de ses archives, pas moins de trente-cinq ans plus tard !
Pour rappel, c’est à la fin des eighties que Benson a collaboré avec le célèbre orchestre de Robert Farnon dont les arrangements luxuriants se mariaient à la perfection avec sa voix soulful et son jeu de guitare si reconnaissable, sur un répertoire mêlant standards américains et relectures de quelques classiques de la pop. Initialement enregistrés par Al Schmidt déjà grammy-awardisé pour certains disques de Benson qui ont cartonné à cette époque, les onze titres gravés ont été aujourd’hui remastérisés par le pianiste arrangeur Randy Walman qui co-produit ce «Dream do come True» ré-imaginé par ses soins, avec des overdubs et des choeurs ré-arrangés.
Voilà donc livré à nos oreilles depuis juillet cet album orchestral inédit où l’on retrouve le grand George avec sa guitare chantante et cette superbe voix, plus crooner que jamais.
Les amoureux de douces ballades seront particulièrement servis puisqu’elles dominent très majoritairement cette soyeuse galette. Après quatre titres dans cette veine en intro qui envoie les violons ( At last avec Tim May à la guitare, le très slowly A song for You, la sérénade de Pretend et la berceuse flûtée de A Long time ago qui s’achève tel un conte féérique). Il faut attendre Love is Blue pour trouver une rythmique enlevée qui groove entre R&B et funky symphonique, bien dans l’esprit de certaines B.O. seventies, avec, derrière le piano de Randy Waldman qui tient aussi la basse, la batterie de Vinnie Colaiuta. Si la guitare bien en avant chante les notes, le scat du vocaliste n’est pas sans rappeler son vieux « pote » Al Jarreau avec lequel nous l’avions d’ailleurs vu à Vienne.
Mais, déjà reviennent les ballades romantiques, avec l’explicite My Romance, Can’t we be friends, My Prayer… Parmi les plus célèbres standards, on aime cette ixième version assez cinématographique de Autumn Leaves croisant feeling vocal, arabesques de harpe et dramaturgie des violons très atmosphériques, comme celle du Yesterday de Lennon-McCartney dans une mouture chaloupée avec les chœurs intéressants ajoutés par Chris Walker, Lynne Fiddmart et Liliana de los Reyes. Avant de conclure par le swing classieux de One Goodbye, jazzifié par le piano et une discrète trompette.
Alors authentique miracle ou opportun coup marketing, qu’importe. On ne résiste pas à l’élégance intemporelle de mister Benson, ce qui le concernant tient du pléonasme.
KATARINA PEJAK «Pearls on a string» (Ruf Records / Socadisc)
 Bien qu’elle ait déjà signé quatre albums dans son pays en bientôt quinze ans de carrière, on découvre la chanteuse-pianiste et compositrice serbe Katarina Pejak avec ce dernier opus paru sur le label allemand Ruf Records, mais enregistré en France où elle s’est installée. Avec son mari Romain Guillot l’ingé son et coproducteur avec elle de ce disque, où la jeune femme qui évolue entre blues, folk, soul et jazz, est entourée d’un beau trio avec Boris Rosenfeld à la guitare, Sylvain Didou à la basse et Johan Barrer à la batterie.
Bien qu’elle ait déjà signé quatre albums dans son pays en bientôt quinze ans de carrière, on découvre la chanteuse-pianiste et compositrice serbe Katarina Pejak avec ce dernier opus paru sur le label allemand Ruf Records, mais enregistré en France où elle s’est installée. Avec son mari Romain Guillot l’ingé son et coproducteur avec elle de ce disque, où la jeune femme qui évolue entre blues, folk, soul et jazz, est entourée d’un beau trio avec Boris Rosenfeld à la guitare, Sylvain Didou à la basse et Johan Barrer à la batterie.
Si elle a commencé à se produire dès l’adolescence dans les clubs de Belgrade, Katarina Pejak fait partie de ces talents européens qui ont traversé l’Atlantique pour aller parfaire leur technique pianistique au réputé Berklee College of Music de Boston. Ainsi assure-t-elle une belle présence au clavier, tandis que sa voix claire, sensuelle, voire franchement lascive parfois, est à situer quelque part entre les folkeuses Joni Mitchell, Rickie Lee Jones, Carole King et le smooth jazz façon Norah Jones.
Typique du blue-folk, le titre éponyme ouvre l’album épaulé par la guitare bluesy de la californienne Laura Chavez en invitée. L’ambiance est à la ballade avec Jeremy’s Boat, la voix se faisant plus salace sur le court Woman qui suit, et fait monter en douceur le swing groovy de ce titre dédié aux femmes, où ronflent les cordes de la basse et qui bénéficie en feat. du sax de Dana Colley venue du groupe de rock alternatif Morphine. Plus axée sur la pop-folk anglaise, It only takes a song est encore une jolie ballade où l’on apprécie le son de Boris Rosenfeld et sa pédale steel. Parmi les pépites, on aime beaucoup Notes on Boredom, chanson de crooner au féminin où la voix sensuelle et sexy de Katarina qui tient fermement son piano bluesy, est soutenue par un fond d’orgue et un balayage des cymbales.
Plus bateau, Excuses mixe pop-rock et R&B façon Ben l’Oncle Soul parmi ces dix titres originaux qui s’agrémentent de deux reprises. D’abord une brillante revisite du Money des Pink Floyd, plus sombre et placée sous la tension électrique d’un Fender Rhodes saturé, tandis que l’orgue fait monter la sauce.Puis Honey Jar emprunté au groupe américain The Wood Brothers, avec là encore plus de muscle dans la guitare, entre blue-rock et country. Mais c’est bien encore l’esprit de ballades sensuelles qui prévaut au final avec le bien nommé Slow Explosion tenant tout à la fois d’un Paolo Conte et d’une Amy Winehouse, ultime compo où Katarina Pejak parachève sa séduction. On dit banco !
MARCH MALLOW «The Silence» (Abrazik / Absilone)
 Passionnés par le répertoire jazz des années 40-50, le guitariste Eric Doboka et le pianiste Christian d’Asfeld se sont associés à la chanteuse Astrid Veigne pour former il y a six ans dans la campagne sarthoise le groupe March Mallow. Nat King Cole et Billie Holiday seront les points de départ de leur écriture musicale, icône d’une période étincelante pour le jazz chanté. S’il n’y a pas de batterie pour conserver une ambiance intimiste, le trio se pare du contrebassiste Thomas Plès dès leur premier album paru en 2020, précédant «A journey in Time» l’année suivante et qui met à l’honneur les deux grandes références précitées. Fort de huit compos originales et seulement deux reprises, leur nouvel opus «The Silence» s’étoffe encore avec la présence du saxophoniste Cédric Thimon, du trompettiste Jean-Pierre Derouard [NdlR : également connu comme batteur], cette fois avec le concours du batteur Alexandre Berton, et même du quatuor à cordes Yule pour la délicate et séduisante reprise du célèbre Mr Bojangles de Nina Simone en clôture.
Passionnés par le répertoire jazz des années 40-50, le guitariste Eric Doboka et le pianiste Christian d’Asfeld se sont associés à la chanteuse Astrid Veigne pour former il y a six ans dans la campagne sarthoise le groupe March Mallow. Nat King Cole et Billie Holiday seront les points de départ de leur écriture musicale, icône d’une période étincelante pour le jazz chanté. S’il n’y a pas de batterie pour conserver une ambiance intimiste, le trio se pare du contrebassiste Thomas Plès dès leur premier album paru en 2020, précédant «A journey in Time» l’année suivante et qui met à l’honneur les deux grandes références précitées. Fort de huit compos originales et seulement deux reprises, leur nouvel opus «The Silence» s’étoffe encore avec la présence du saxophoniste Cédric Thimon, du trompettiste Jean-Pierre Derouard [NdlR : également connu comme batteur], cette fois avec le concours du batteur Alexandre Berton, et même du quatuor à cordes Yule pour la délicate et séduisante reprise du célèbre Mr Bojangles de Nina Simone en clôture.
Si ce nouvel opus nous plonge dans une atmosphère en noir et blanc, assez cinématographique, on y pénètre comme dans l’antre souterraine d’un club de jazz où baigne une certaine mélancolie envoûtante, et où les époques se mêlent en créant des passerelles émotionnelles entre swing et ballades bluesy. Surtout, ce qui distingue March Mallow depuis le début, c’est que pour mieux coller à la couleur sépia de leur musique, leurs techniques d’enregistrements sont identiques à celle de l’époque, et particulièrement par l’utilisation de micros à ruban stéréo. Apparus dans les années trente, ils étaient la référence de tous les studios comme au cinéma et à la radio. Cette recherche d’un son purement acoustique avec une disposition adéquate des musiciens dans la même pièce, permet de retrouver l’âme d’un son organique, la simplicité et la sincérité des standards livrés par les plus grands interprètes du jazz vocal d’après-guerre.
Dès après le groove nonchalant de Dreaming Love en ouverture, le swinguant Peaceful Place révèle la voix d’Astrid Veigne, courte pièce comme le sont la plupart du répertoire (souvent moins de trois minutes). Plus jazzy au son de la contrebasse, Sometimes précède deux pépites, Fool’s Train et son swing speedé par les cuivres façon « Triplettes de Belleville », sous la pompe de la guitare où vient se poser une trompette en solo. On aime aussi beaucoup la douceur mélancolique appliquée sur Des Couleurs chanté en français, avec sa caresse de sax. Curieusement, c’est le titre éponyme The Silence qui nous laisse… en silence, avec un tout autre univers plus pop qu’on trouvera incongru et comme anachronique.
Après une courte mais très probante version du fameux I put a smell on you, le charme sonore de tous les instruments jaillit sur la ballade piano-jazz de Simplement. Avant de conclure on l’a dit sur Mr Bojangles avec les cordes de Yule, March Mallow offre un clin d ‘œil perso à ce standard avec Bo Jungle, deux minutes de swing emmené par le piano et la rythmique arrière et où le sax a le temps d’envoyer un bon chorus. Certainement un groupe à découvrir pleinement en live.
EYM Trio «Casablanca» (Kollision Records)
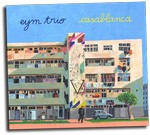 Si leur «Bangalore» paru l’an dernier était peut-être par trop marqué de la présence de la chanteuse indienne Varijashree Venugopal, en nous déroutant du EYM trio que nous connaissions auparavant, les Lyonnais qui n’ont pas chômé reviennent aux fondamentaux avec ce cinquième album qui se recentre sur leurs bases fondamentales de trio instrumental de jazz contemporain tendance E.S.T. Mais toujours nourri de leurs pérégrinations sans frontières et des collaborations diverses initiées au gré de leurs aventures. Or si Bangalore donnait explicitement la couleur, il ne faut pas croire que Casablanca soit cette fois dévolu à la culture musicale du Maroc. C’est juste parce que c’est dans cette ville que nos musiciens ont rencontré le dessinateur Simon Lamouret, qui signe joliment les illustrations de cet album.
Si leur «Bangalore» paru l’an dernier était peut-être par trop marqué de la présence de la chanteuse indienne Varijashree Venugopal, en nous déroutant du EYM trio que nous connaissions auparavant, les Lyonnais qui n’ont pas chômé reviennent aux fondamentaux avec ce cinquième album qui se recentre sur leurs bases fondamentales de trio instrumental de jazz contemporain tendance E.S.T. Mais toujours nourri de leurs pérégrinations sans frontières et des collaborations diverses initiées au gré de leurs aventures. Or si Bangalore donnait explicitement la couleur, il ne faut pas croire que Casablanca soit cette fois dévolu à la culture musicale du Maroc. C’est juste parce que c’est dans cette ville que nos musiciens ont rencontré le dessinateur Simon Lamouret, qui signe joliment les illustrations de cet album.
Ici le trio s’amuse avec des éléments de langage sonore venant des quatre coins du monde, le tout dans des métriques innovantes laissant place à une grande liberté d’interprétation où c’est la légèreté dans le lâcher prise qui invite au voyage. Dans la continuité du projet « Nomad’ Sessions » initié en 2019, avec comme état d’esprit un jazz mélodique sans barrières, où l’on retrouve certaines influences notoires chez le pianiste Elie Dufour (qui écrit pour le groupe sans directives précises, mais donne des bases à remodeler selon la sensibilité de ses camarades), notamment bulgares, tziganes et orientales au sens large. L’occasion pour lui de dévoiler ici une innovation pianistique qu’il a mis au point durant les confinements avec Robert Kieffer, une pédale mécanique et acoustique permettant de muter la partie centrale du piano et accéder ainsi à des modes de jeux inédits. Omniprésente sur cet album, elle donne au clavier la capacité de sonner comme un instrument nouveau, proches de ceux à cordes pincées comme le oud.
Le titre piquant Pic Nic in Tchernobyl ouvre sur plus de six minutes atmosphériques, en alerte comme le jazz nerveux et très contemporain du trio. La belle contrebasse de Yann Phayphet résonne le temps d’un interlude débouchant sur le long titre éponyme Casablanca, où le tempo du piano en piqué profond impose comme une urgence, sur une rythmique cordes et batterie (tenue par Marc Michel) qui donne un côté afro à cette pièce où en tout cas, on est bel et bien par delà la Méditerranée. A la vivacité de jeu d’Elie s’ajoute le superbe tricot de Yann et ses bourdonnements à l’archet, où les cordes de la contrebasse sonnent comme une guitare afro.
Apaisée et plus contemplative, Song for Amilou est toute empreinte de douceur. Est-ce le nom de sa fille ? Cette tendresse ressemble assurément beaucoup à celle du regard d’un père sur son enfant. Autre joli thème toujours mené par un piano percutant, Merapi s’étire sur près de sept minutes avec une contrebasse décidément en action incessante, résonnant au gré d’un manche maîtrisé avec autant de vélocité que de doigté. De belles cordes qui se confondent à un violoncelle au fil du plus climatique Spleen, le bien nommé, avant un éreintant No Madness lui aussi bien (trop) long.On préfère l’aspect contemplatif et la nostalgie qui exhale du piano sur Midnight Damper, avant que Do I know you écrit cette fois par Marc Michel mette un terme à ce voyage sonore intense, du genre captivant.